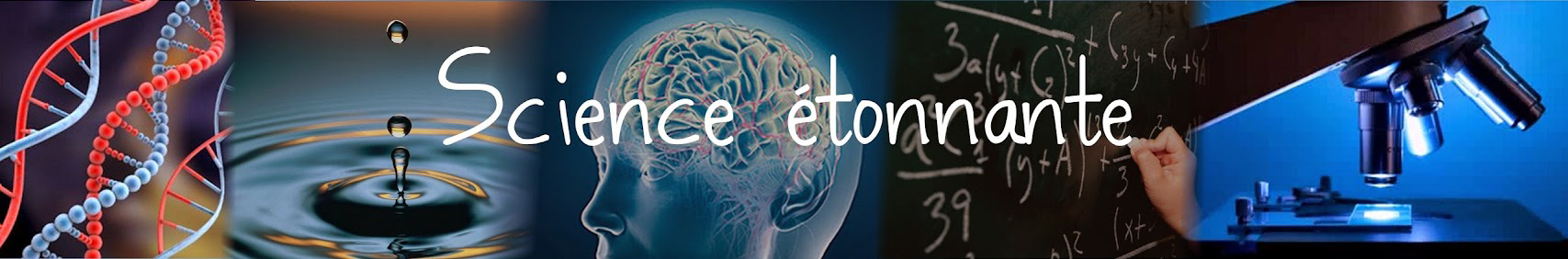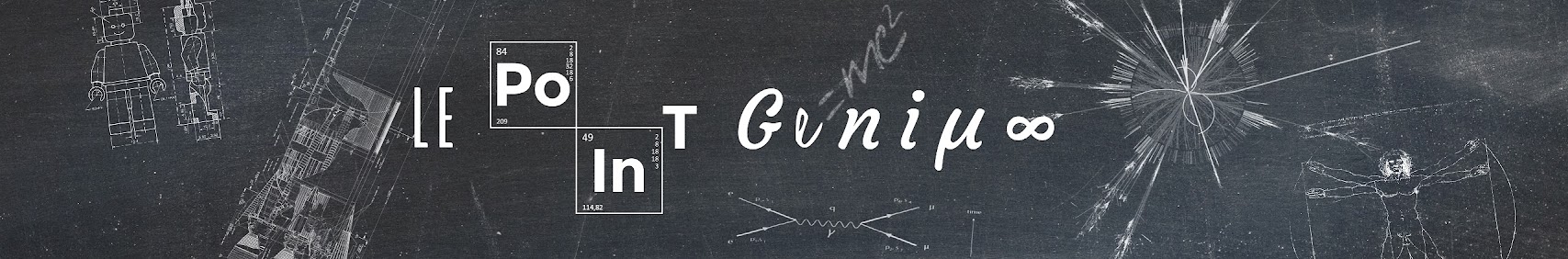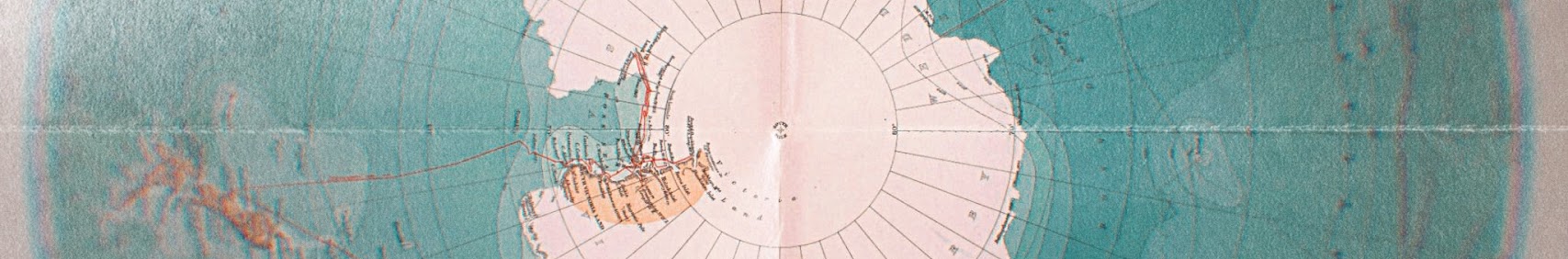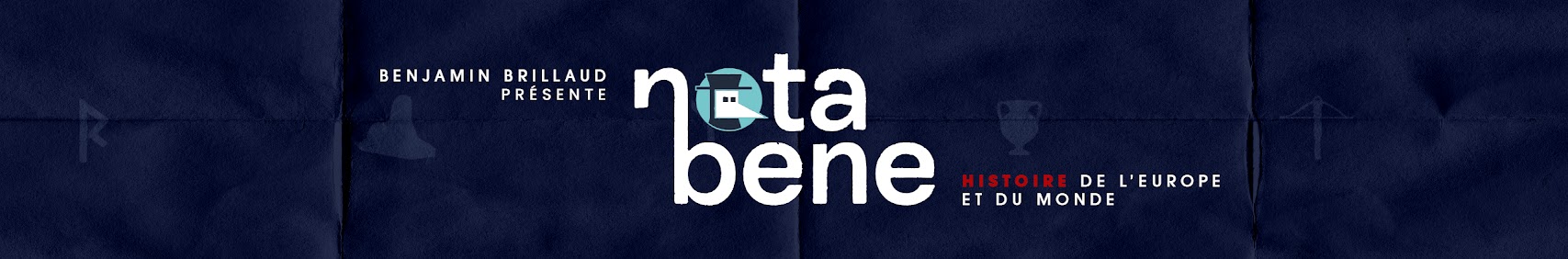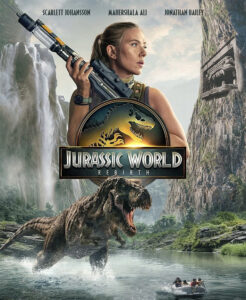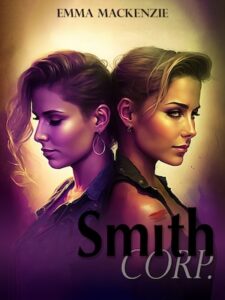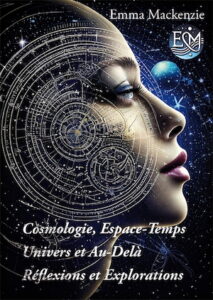🎬 Critique Maison – Kaamelott : Deuxième Volet, Partie 1 (2025)
Une fresque française d’une ampleur rare, où l’humour absurde, la tragédie et la noblesse s’entrelacent avec une justesse qu’on n’espérait plus.
Astier transforme Kaamelott en véritable épopée de cinéma — fidèle à son âme, mais portée par une maturité et une émotion nouvelles.
Note : ⭐️ 4.4 / 5
Réalisé par : Alexandre Astier
Avec : Alexandre Astier, Anne Girouard, Alain Chabat, Clovis Cornillac, Guillaume Gallienne, Redouane Bougheraba, Virginie Ledoyen, Serge Papagalli, Joëlle Sevilla, Jean-Christophe Hembert, Jacques Chambon, Lionel Astier…
🕯️ Pitch d’entrée
Vingt ans après les premières capsules diffusées sur M6, Alexandre Astier redonne vie à son royaume de Bretagne, mais cette fois sur le grand écran avec toute l’ambition d’une fresque.
Fini le format de cinq minutes, les sketchs à la chaîne et les vannes en rafale : Kaamelott devient cinéma. Entre les ombres de Ban et la lumière d’une nouvelle Table Ronde, Arthur revient, malgré lui, affronter ses fantômes, ses dieux, et son propre héritage.
⚜️ Contexte et attentes
Quatre ans d’attente, c’est long. Très long, surtout quand on est fan de Kaamelott.
Le premier volet avait divisé, mais il avait aussi prouvé que l’univers d’Astier pouvait exister sur grand écran — et ce, malgré la période Covid, la contrainte des tournages et la pression de toute une communauté suspendue à son œuvre.
Alors forcément, ce deuxième volet était attendu comme le Graal.
Pour bien comprendre l’importance de ce film, il faut revenir à la genèse du projet. À l’origine, M6 voulait sept saisons de cent épisodes de cinq minutes pour combler le créneau laissé vide par Caméra Café.
Mais Alexandre Astier, lui, voulait déjà faire grand. Le format court l’a propulsé, mais il l’a aussi limité. Dès les Livres V et VI, il avait allongé la durée des épisodes, donnant plus de souffle, plus de profondeur, plus de tragédie — et ça, M6 n’en voulait plus. Le Livre VII n’a donc jamais vu le jour, et Astier l’a condensé en film.
Ce premier film, Kaamelott – Premier Volet, était une transition, une passerelle fragile entre la série et le cinéma. Difficile d’y mettre toute la densité prévue pour six ou huit épisodes d’une heure dans à peine 2h30 de pellicule.
Le deuxième volet, lui, est le premier vrai Kaamelott pensé pour le cinéma.
Les attentes étaient immenses. L’enjeu, colossal.
Et Astier, fidèle à lui-même, n’a pas choisi la facilité. Il a préféré le risque, l’ambition et une vraie écriture de cinéma.
Là où Caméra Café s’est cassé la figure en essayant de transposer son humour de bureau sur grand écran, Kaamelott, lui, a su évoluer.
C’est un pari audacieux : transformer une série culte en une saga de fantasy à la française. Et franchement, à mes yeux, c’est une réussite.
🌄 Le visuel, la photographie et les décors
Dès les trois coups de trompes, la magie opère. On sait tout de suite qu’on est de retour dans Kaamelott.
Le premier plan donne le ton : une vue aérienne splendide des ruines de la forteresse, survolées par des nuées d’oiseaux dans une lumière grisâtre, désaturée, presque maladive. Une ambiance poisseuse, ancienne, lourde de sens.
Le deuxième plan, panoramique, montre le même décor, mais de plus près, avec un personnage mystérieux de dos — druide, mage, ou spectre, on ne sait pas encore — qui frappe le sol de son bâton. BAM. En un geste, le son, la puissance et le style visuel du film s’imposent.
C’est beau, c’est précis, c’est propre.
Les plans sont grands, bien composés, lumineux quand il faut, sombres quand il faut. Les décors sont impressionnants : on est à mille lieues du carton-pâte des débuts de la série. On sent que les moyens ont été mis là où il fallait, et c’est bluffant pour une production française.
Les effets spéciaux (CGI, matte painting…) sont d’une discrétion rare : ils ne jurent jamais avec l’image réelle.
Même les apparitions d’esprits — comme le Roi Ban, énorme halo de fumée anthropomorphique, ou encore l’entité des ténèbres “Sarlok” (si je prononce bien son nom 😅) — s’intègrent parfaitement aux environnements naturels.
La lumière, la colorimétrie, les contrastes… tout est cohérent. Rien ne dénature la scène, rien ne “fait plastique”.
C’est justement ça, la force visuelle du film : le grandiose sans la lourdeur.
Astier n’en fait jamais trop. Là où beaucoup de productions se perdent dans la surenchère de CGI au point d’en devenir indigestes, ici, tout est mesuré, harmonieux.
Le CGI soutient la mise en scène, il ne la dévore pas.
Seul petit bémol : la forteresse de Ban.
Dans le premier volet, elle n’était qu’une simple tour en ruine, isolée, sobre. Ici, elle devient un vaste complexe en ruine, rempli de dépendances, de débris, d’escaliers branlants. Ça casse un peu la continuité visuelle entre les deux films, mais on comprend vite pourquoi ce choix a été fait : il fallait un espace plus vaste pour raconter la chute de Lancelot, son isolement, sa folie et ses dialogues avec le fantôme de son père.
Donc oui, il y a un léger faux raccord… mais justifié.
Le film a été tourné dans plusieurs pays, et ça se sent.
Les paysages sont variés, somptueux, respirent la grandeur : on passe des ruines brumeuses aux terres verdoyantes, puis à des régions glacées, avec cette impression d’immensité rare dans un film français.
Chaque décor est à sa place, chaque couleur raconte une émotion.
Visuellement, Kaamelott 2 est une réussite totale.
Tout est calibré, fluide, équilibré. Rien ne sonne faux.
C’est beau, tout simplement. Éblouissant, même.
Et la beauté du film, c’est qu’il en met plein les yeux sans jamais en mettre plein la figure.
🎻 La bande-son et l’ambiance musicale
Dès les premières notes, on reconnaît la patte d’Astier.
Ce style orchestral qu’il a toujours su marier à son univers, à la fois majestueux et intime, grandiose mais sans jamais être pompeux.
La bande originale de ce deuxième volet s’inscrit dans la continuité directe du premier film : du pur Astier.
Les orchestrations sont somptueuses, puissantes, et pourtant d’une douceur incroyable à l’oreille. On n’est jamais agressé.
La musique accompagne le récit, elle ne l’écrase pas. Elle soutient les émotions, les silences, les regards, les transitions, sans jamais s’imposer à la place des dialogues.
C’est du vrai travail de compositeur — pas de simple habillage sonore.
On sent à chaque instant qu’Astier connaît le rythme de ses images, qu’il compose la musique comme il écrit ses scènes : au millimètre.
Et ce souci de précision se ressent tout du long.
Chaque thème revient avec une justesse calculée. Les envolées orchestrales se font au bon moment, ni trop tôt, ni trop tard.
L’ambiance sonore du film est donc d’une équilibre rare : elle amplifie les émotions sans jamais saturer les tympans.
Même mon amie, en sortant du cinéma, me l’a dit sans que je lui souffle quoi que ce soit : “La musique, elle était parfaite, pas trop forte, pas trop présente… juste ce qu’il fallait.”
Et c’est exactement ça.
Là encore, Astier prouve qu’il sait faire grand sans en faire trop.
C’est une bande-son à la fois noble et humble, taillée pour un film d’aventure dramatique mais pensée avec la retenue d’un musicien amoureux de son œuvre.
Résultat : c’est magnifique.
Les thèmes sont puissants, les orchestrations superbes, et pourtant, on ressort de la salle sans bourdonnement d’oreille, juste avec l’émotion d’avoir écouté quelque chose de juste.
C’est exactement ce que j’attends d’une bande originale de film : qu’elle me fasse vibrer avec le film, pas à sa place.
Et là-dessus, Astier est, encore une fois, irréprochable.
⏳ Rythme et narration
Sur ce point-là, le film divise clairement les spectateurs — et honnêtement, je comprends pourquoi.
D’un côté, il y a ceux qui attendaient la folie des capsules de cinq minutes : des vannes à la seconde, du rythme, des mimiques, des punchlines en rafale.
De l’autre, ceux qui comprennent qu’on ne peut pas tenir deux heures et demie de film avec une avalanche de sketchs.
Et c’est là que le génie d’Alexandre Astier opère.
Il a compris que Kaamelott ne pouvait pas rester figé dans son format initial.
Il fallait évoluer, grandir, raconter autrement. Et il l’a fait.
Le passage de la capsule comique au film d’aventure dramatique, il le gère à la perfection.
Il mélange l’humour, le drame, l’émotion, la quête, et tout ça coule naturellement. On ne s’ennuie pas une seconde.
Le rythme est parfaitement dosé : il y a des moments drôles, tendres, émouvants, d’autres plus lents, presque contemplatifs, mais tout s’enchaîne avec une fluidité incroyable.
Le spectateur a le temps de respirer, de s’attacher, de comprendre.
Et ça, c’est essentiel.
Un film n’est pas une série : il faut laisser au public le temps d’assimiler ce qu’il voit.
Astier le sait, et il ne cède pas à la tentation du montage frénétique.
Les scènes prennent le temps de vivre.
Elles s’installent, se développent, laissent place à l’image et au silence.
Et paradoxalement, c’est ce qui rend le film captivant.
Les 2h30 filent sans qu’on s’en rende compte.
Quand le générique arrive, on se dit “déjà ?”. Et pourtant, on vient de passer plus de deux heures dans un monde qu’on aurait aimé encore explorer.
Certains reprocheront quelques lenteurs, certaines séquences jugées inutiles.
Mais il faut remettre les choses dans leur contexte : cette Partie 1 est une mise en place.
C’est un chapitre de transition, un socle narratif avant la montée en puissance de la suite.
Tout est là pour installer les nouveaux enjeux, les nouveaux personnages, les nouvelles quêtes.
Et Astier le fait avec patience et cohérence.
Le film se termine brutalement, presque sans prévenir, mais c’est voulu.
C’est un cliffhanger maîtrisé, calculé.
On sent qu’il a pensé cette coupure pour frustrer juste ce qu’il faut, afin de relancer la tension jusqu’à la Partie 2.
Je le répète souvent : le génie d’Astier, c’est de faire les choses comme il le veut, pas comme on les attend.
Et c’est exactement ce qu’il fait ici.
Concernant le ton général, cette narration plus posée dessert un peu certains acteurs qui, eux, viennent d’un registre plus “série capsule”.
Par exemple, Perceval et Karadoc (dans le premier volet surtout) avaient tendance à surjouer leurs tics de langage et leurs attitudes comiques.
Ce qui, sur grand écran, paraît plus appuyé, plus caricatural.
Mais c’est aussi ce qui fait leur charme : ils restent fidèles à eux-mêmes, à leurs origines, à leur rythme propre.
Et franchement, mieux vaut garder la sincérité des personnages que de les “lisser” pour coller aux codes du cinéma.
Kaamelott, c’est avant tout une œuvre d’équilibre entre noblesse et absurdité.
Pour moi, cette narration posée, claire, un peu contemplative par moments, fait du bien.
Elle prouve qu’on peut encore, au cinéma, prendre le temps de raconter.
Et surtout, elle montre qu’Astier a réussi son pari : faire du vrai cinéma avec l’âme d’une série.
👥 Le casting général et les différences d’acting
Le casting est colossal. Vraiment.
On retrouve les anciens, les plus jeunes qui ont pris de l’âge, et une belle brochette de nouveaux venus.
Et il faut le dire : chacun tient son rôle.
Je pense que cette longue liste de personnages était nécessaire.
Astier devait construire de nouveaux duos, trios, équipes d’aventuriers — parce que ce renouveau de Kaamelott, c’est aussi la promesse de nouvelles quêtes, de nouvelles histoires, d’une transmission entre générations.
Les anciens, moins présents sur le terrain, laissent la place aux jeunes chevaliers, aux nouvelles figures, tout en gardant ce fil qui relie la grande époque de Kaamelott à ce qu’il devient aujourd’hui.
Et ça fonctionne.
Franchement, je n’ai ressenti aucune lourdeur, aucun excès, aucun personnage “inutile”.
Chaque apparition a son sens, chaque dialogue trouve sa place.
Tout s’agence de manière fluide et logique, même avec un casting aussi large.
Le plus étonnant, c’est à quel point Astier arrive à équilibrer tout ce monde sans que personne ne marche sur les pieds de l’autre.
Personne n’est laissé de côté, même ceux qu’on ne voit que quelques instants.
Et on sent bien que beaucoup d’entre eux auront un rôle bien plus important dans la deuxième partie.
Alors oui, les visages ont changé.
Les années passent, et certains personnages portent plus visiblement le poids du temps.
Mais là encore, c’est justifié.
La période de dictature de Lancelot a figé tout le monde dans une sorte de latence.
Dix ans d’isolement, de peur, d’inactivité… ça laisse des traces.
Ça explique pourquoi certains personnages n’ont pas vraiment évolué dans leur mentalité, leur maturité ou leur manière d’être.
Gauvain, par exemple.
Physiquement, il a pris de l’âge, mais son caractère de gamin un peu simplet est resté le même.
Et finalement, c’est cohérent.
On peut facilement imaginer que ces dix années de tyrannie ont figé son développement personnel.
C’est la même chose pour Guenièvre, d’ailleurs.
Son physique a changé, elle s’est embellie, elle a gagné en prestance, mais son esprit reste celui de la Guenièvre naïve et rêveuse d’autrefois.
Là encore, c’est logique : enfermée pendant des années dans la tour de Ban, coupée du monde, sa maturité émotionnelle n’a pas pu évoluer.
Et puis il faut reconnaître qu’Astier n’a pas réuni un casting “lisse”.
On a des acteurs de théâtre, de télévision, de cinéma, des humoristes, des youtubeurs…
Chacun avec son bagage, son rythme, son expérience du jeu et de la caméra.
Le théâtre, par exemple, exige de “pousser” la voix et les émotions, pour que tout le public ressente ce qui se passe sur scène.
Le cinéma, à l’inverse, demande de l’intériorité, de la retenue, du naturel.
Et certains acteurs, forcément, ont encore un pied dans le premier registre.
Du coup, il y a parfois des différences de ton ou de rythme entre les dialogues.
Mais tu sais quoi ?
Ça fait partie du charme de Kaamelott.
Parce qu’au final, ce joyeux mélange de styles reflète exactement ce qu’est l’univers d’Astier : un monde plein d’âmes différentes, d’énergies contraires, de maladresses touchantes et de sincérités imparfaites.
Oui, on sent la différence d’acting entre certains.
Oui, parfois une réplique sonne un peu “théâtre”, un peu forcée.
Mais on s’en fiche.
Parce que Kaamelott n’a jamais reposé sur la perfection : il repose sur l’authenticité.
Et dans ce film, tout le monde joue vrai.
Même ceux qui jouent mal, jouent juste.
Et ça, c’est la marque d’un univers cohérent, vivant, et profondément humain.
🌟 Focus personnages
Arthur
Arthur, c’est la colonne vertébrale du film.
Toujours en dépression, toujours en guerre contre les dieux, toujours prisonnier de sa propre légende.
Il porte le poids de tout un royaume, sans plus vouloir en être le roi.
C’est ce conflit permanent qui le rend aussi humain : il est fatigué, brisé, mais profondément juste.
Dans ce volet, il refuse clairement son statut.
Il rejette la royauté, refuse d’utiliser Excalibur, renie même les symboles de son ancienne grandeur.
Et pourtant… il reste Arthur.
Celui qu’on écoute, celui qu’on suit, celui qui inspire sans le vouloir.
Son monologue sur la nouvelle Table Ronde est bouleversant.
On y retrouve le Arthur du Livre I, “Arthur le Juste”, celui qui croyait encore au sens de tout ça.
Quand Léodagan lâche un “Il m’a eu”, c’est un aveu : malgré sa fatigue, Arthur garde ce magnétisme de chef.
Et sa relation avec Guenièvre, toujours oscillant entre tendresse et exaspération, ajoute une humanité incroyable à son personnage.
Lorsqu’elle est frappée par la foudre divine et qu’il se précipite vers elle, c’est un moment sincère, touchant. On sent que, malgré tout, il l’aime.
Astier reste fidèle à lui-même dans son jeu : sobre, précis, charismatique sans en faire trop.
Arthur est son reflet : un homme de raison, mais plein de contradictions.
Guenièvre
Anne Girouard, quelle évolution !
Physiquement, elle a changé, mais en bien : elle s’est affinée, elle s’est embellie, elle dégage une vraie prestance.
C’est une Guenièvre plus femme, moins godiche — même si son caractère reste fidèle à la série.
Là où certains pourraient voir un décalage entre son physique plus mature et sa naïveté, moi je trouve que ça fonctionne.
Elle a été enfermée pendant dix ans par Lancelot, isolée du monde.
Comment pourrait-elle avoir évolué autrement ?
Sa maturité émotionnelle s’est figée, et ça se ressent.
Et Anne Girouard le joue à la perfection.
Chaque regard, chaque phrase prononcée avec cette innocence désarmante, rappelle la Guenièvre qu’on aime depuis toujours, mais avec une profondeur nouvelle.
Lancelot
Lancelot, c’est la déchéance incarnée.
Gris, décharné, sale, presque méconnaissable.
Il vit reclus dans les ruines de la forteresse de Ban, hanté par le fantôme de son père.
Il essaie désespérément d’attirer son attention, en vain.
Sa descente est magnifiquement mise en scène.
Tout, autour de lui, est froid, désaturé, brumeux.
Même la lumière semble l’avoir abandonné.
Et ce contraste visuel souligne à merveille son état d’esprit : un homme consumé, vidé, brisé.
L’apparition de l’araignée géante, conséquence de ses tentatives de magie noire, est aussi dérangeante que fascinante.
Quand il enfile à nouveau son armure en lambeaux du premier volet, on sent toute la symbolique de la chute : ce n’est plus le chevalier blanc, c’est une épave de gloire.
Et sans Méléagant pour le manipuler, il n’est plus qu’une ombre.
Méléagant
Et justement, parlons-en, de Méléagant.
J’avoue : il m’a déçue.
Dans la série, c’était une entité terrifiante, mystérieuse, démoniaque.
Une présence malaisante, presque cosmique.
Ici, il revient, mais sans la même aura.
Ses répliques sont plus neutres, moins venimeuses, moins manipulatrices.
Il ne dégage plus cette noirceur envoûtante qu’il avait avant.
Je m’attendais à un vrai retour du monstre de l’ombre, celui qui tire les ficelles dans le dos, celui qui murmure à l’oreille des faibles.
Mais non. Il subit un peu plus qu’il n’agit.
C’est dommage, mais j’espère qu’Astier lui réserve quelque chose de plus fort dans la partie 2.
Le Duc d’Aquitaine
Alain Chabat, toujours égal à lui-même : génial.
Son personnage s’embourgeoise de film en film, et c’est délicieux.
Ses costumes sont un festival visuel : couleurs criardes, plumes de paon, barbe et cheveux blancs ébouriffés…
C’est extravagant, ridicule, et pourtant parfaitement cohérent.
Chabat en fait juste assez, sans tomber dans le clownesque.
C’est un vrai bonheur à chaque apparition.
Le Tavernier
Alors là, quelle surprise !
Le Tavernier, pilier discret des scènes comiques, prend enfin de l’ampleur.
Cette fois, il part à l’aventure avec Karadoc, la Dame du Lac et Vénec.
Et il laisse sa Taverne entre les mains de ses deux sous-fifres… et de Kadoc. 😅
Autant dire que je n’ose même pas imaginer le chaos que ça va devenir.
J’en rigolais déjà dans la salle.
Ce renversement est malin : voir le Tavernier sur la route, dans l’action, pendant que le bordel s’installe à la Taverne, c’est du pur Kaamelott.
C’est une idée brillante, pleine de potentiel pour la suite.
Gauvain
Gauvain, c’est un cas à part.
Toujours ce ton traînant, cette naïveté un peu absurde, ce phrasé si particulier… mais avec le visage d’un homme mûr.
Et ça, ça a pu déranger certains.
Mais moi, j’y vois une logique narrative.
Dix ans de tyrannie, dix ans d’isolement, dix ans sans aventure… comment évoluer dans ces conditions ?
Gauvain est resté le même, figé dans le temps, et ça colle parfaitement à la situation.
Les Dames de Tintagel : Ygerne, Cryda et Ana de Tintagel
La scène avec Ygerne et Cryda, c’est du pur Kaamelott : deux mégères méprisantes, médisantes, qui ramènent avec elles ce parfum de la série d’origine.
Elles ne font pas avancer l’intrigue, mais elles rappellent d’où on vient.
Leur échange sur le lit et la discussion sur “le souci de l’héritier” sont de vrais petits bonbons comiques.
Par contre, j’ai été déçue par Ana de Tintagel.
Virginie Ledoyen joue bien, mais elle ne dégage pas la même autorité naturelle qu’Anouk Grinberg.
Là où Grinberg imposait le respect par un simple regard, Ledoyen semble plus… décorative.
Et son costume, un peu trop inspiré de “Maleficent”, n’aide pas.
On perd la noblesse cruelle d’Ana au profit d’une image de sorcière stylisée.
C’est joli, mais moins fort.
J’espère qu’elle sera plus percutante dans la partie 2.
Le trio Quarto, Alzagar et Silas
Une réussite totale.
Ces trois-là, c’est la nouvelle bouffée d’air frais du film.
Cornillac, Gallienne et Bougheraba forment un trio parfaitement équilibré :
le flegme, la bêtise, la nonchalance… tout y est.
Leurs interactions sont hilarantes et leurs dialogues écrits au scalpel.
La réplique “C’est miraculeux que vous ayez pu faire une carrière somme toute impressionnante tout en étant aussi con” m’a pliée de rire.
Ce genre de moment, c’est du vrai Kaamelott : absurde mais cinglant, drôle mais intelligent.
Et puis, leur mission d’observation qui tourne mal est un vrai petit film dans le film.
Une mini-aventure parfaitement gérée, rythmée, drôle, et essentielle pour l’équilibre global du long-métrage.
Les Trévoriens et les Lucaniens
Les deux équipes de jeunes chevaliers sont un peu plus inégales, mais j’aime ce qu’elles apportent.
On sent le passage de flambeau, la relève.
Trévor et Lucan, avec leur petite guerre fraternelle à cause de “l’épée sèche”, donnent des moments à la fois drôles et touchants.
Et puis voir Gauvain les encadrer en pseudo-mentor, c’est parfait.
Il y a un vrai potentiel comique et narratif pour la suite.
Bohort
Toujours fidèle à lui-même, mais plus mûr.
Il garde sa prudence, son angoisse, sa bonté.
Mais cette fois, il assume un vrai rôle de guide, presque de chef de transition.
C’est lui qui tente de garder tout le monde à flot, même les plus irrécupérables.
Et il le fait avec cœur.
Les paysans : Roparzh, Guethenoc et Petrok
Ah… nos deux compères rustiques !
Toujours fidèles à leur réputation : bagarreurs, mauvais perdants, obsédés par leurs champs et leurs boissons douteuses.
Mais ici, l’ajout de Petrok (le fils de Roparzh, incarné par la fille d’Astier, Mebhen) apporte un vrai plus.
C’est le gestionnaire moderne, obsédé par la rentabilité, l’agriculture raisonnée, les chiffres.
Un contraste délicieux avec ses deux vieux crétins d’amis, qui ne comprennent rien à sa logique.
Les voir tous les trois ensemble, c’est un pur moment de Kaamelott, entre chamailleries et philosophie de comptoir.
Les mages : Merlin, Elias et Conle le Fameux
Ce trio-là, c’est une pépite.
On connaissait la rivalité entre Merlin et Elias, éternelle et délicieusement idiote.
Mais avec Conle, on passe à un autre niveau.
“Le Fameux Con’le”, comme ils disent, est plus érudit, plus posé, plus intelligent… et du coup, il agace encore plus les deux autres. 😄
Leur trio fonctionne à merveille.
C’est absurde, bourré de quiproquos, de sorts foireux, de phrases savantes complètement inutiles…
Bref, du pur Kaamelott.
Et la petite découverte qu’ils font à la fin annonce clairement un gros mystère à suivre dans la partie 2.
Et enfin… Horsa (Sting)
Son absence m’a un peu frustrée, je l’avoue.
Après la scène de fin du premier volet, je m’attendais à le revoir ici, même brièvement.
Mais avec un casting déjà aussi dense, je comprends le choix de le garder pour la suite.
Son arrivée promet d’être marquante, et j’espère qu’elle le sera.
🛡️ Le cas Perceval / Franck Pitiot
Ah… le fameux sujet sensible.
Dès l’affiche du film, on savait : Franck Pitiot n’était pas au casting.
Et pourtant, Perceval, lui, n’a pas disparu. Pas vraiment.
L’annonce avait fait grand bruit.
Les réseaux s’étaient enflammés, les fans s’étaient divisés, les théories les plus farfelues circulaient.
Certains criaient au scandale, d’autres cherchaient la logique artistique derrière ce choix.
Et, comme souvent avec Kaamelott, la vérité est plus nuancée qu’on ne le croit.
Pitiot n’a pas claqué la porte. Il n’y a pas eu d’engueulade avec Astier, pas de drame caché ni d’incompatibilité d’agenda.
C’est beaucoup plus simple — et, quelque part, plus noble.
Après avoir lu le script, Pitiot n’a pas reconnu son Perceval.
Il a senti que le personnage ne correspondait plus à ce qu’il imaginait de lui, à son évolution, à sa nature.
Et plutôt que de jouer un rôle qu’il ne comprenait pas — ou qu’il ne ressentait pas juste — il a préféré se retirer.
Et honnêtement ? Je le respecte profondément pour ça.
Ce n’est pas un caprice, ni un désaccord d’ego. C’est une vraie question d’intégrité artistique.
Quand on incarne un personnage aussi iconique, qu’on l’a façonné, habité, aimé pendant des années, on ne veut pas le trahir.
Et Pitiot a fait ce choix, courageux mais cohérent : ne pas “faire du Perceval” pour faire plaisir, mais attendre de pouvoir le rejouer s’il redevient celui qu’il reconnaît.
Je comprends sa position.
Déjà dans le premier film, j’avais trouvé le duo Perceval / Karadoc un peu caricatural.
Ils étaient devenus une version exagérée d’eux-mêmes, sans la finesse et la profondeur comique qu’ils avaient dans les livres plus longs.
Leur complicité restait là, bien sûr, mais un peu figée dans le “running gag”.
Si le deuxième volet allait encore accentuer ce décalage, je comprends que Pitiot ait eu du mal à s’y retrouver.
Astier, de son côté, a su gérer l’absence avec intelligence.
Il n’a pas effacé Perceval : il l’a fait vivre autrement.
Dans cette Partie 1, Perceval est en vadrouille, parti seul en quête, fâché avec Karadoc.
Et il envoie des lettres. Des missives d’une naïveté adorable, pleines d’innocence, de maladresses et de logique tordue.
C’est un vrai bonheur de lecture à l’écran — presque un hommage au personnage.
C’est malin, doux, et même un peu émouvant.
Parce que, malgré tout, on sent qu’il est là.
Son esprit flotte toujours au-dessus de la Table Ronde, comme un souffle de légèreté au milieu des tensions.
Alors oui, son absence se ressent.
Le duo des Semi-Croustillants manque, clairement.
Mais l’équilibre global du film n’en souffre pas.
Kaamelott n’est pas amputé, juste différent.
Et je garde bon espoir que les choses s’apaisent.
Astier et Pitiot se respectent mutuellement, on le sent dans leurs interviews.
Je ne serais pas surprise qu’on retrouve Perceval dans la Partie 2 ou le troisième volet, ne fût-ce que pour un clin d’œil symbolique.
Parce que soyons honnêtes : Kaamelott sans Perceval, c’est un peu comme un banquet sans vin.
On peut s’en passer… mais c’est quand même moins savoureux. 🍷😌
🎬 Conclusion à chaud
On reste clairement dans la lignée du premier volet : un film qui divise, et qui continuera de le faire.
C’est inévitable.
Kaamelott, c’est une œuvre d’auteur, une vision unique. Et quand on touche à quelque chose d’aussi culte, tout le monde a son idée de ce que “ça devrait être”.
Certains attendaient le Kaamelott des débuts : les blagues, le rythme, la folie verbale.
D’autres voulaient un vrai film de cinéma, ample, profond, visuellement fort.
Astier a choisi son camp : celui du Grand Cinéma.
Et il a bien fait.
Il a compris que Kaamelott ne pouvait plus se contenter d’être une série culte — il devait devenir une saga.
Ce n’est plus seulement une comédie historique : c’est une fresque humaine, dramatique, drôle, poétique, tout à la fois.
Et c’est là que réside sa grandeur.
Oui, cette première partie ne donne pas toutes les réponses.
Oui, certains diront qu’il ne “se passe pas grand-chose”.
Mais c’est normal.
C’est une mise en place, un socle, un tremplin pour la suite.
Les fondations d’un renouveau complet : nouveaux personnages, nouvelles alliances, nouveaux enjeux.
Le film se termine sur une suspension, un fil tendu, une promesse.
Et c’est justement ça qui me plaît : cette impression qu’Astier construit patiemment un monument, pierre après pierre, sans céder à la pression.
J’ai lu des critiques très dures, parfois injustes.
Mais au fond, elles disent toutes la même chose : Kaamelott ne laisse personne indifférent.
Et c’est bien la preuve qu’il reste vivant.
Pour ma part, j’ai adoré.
J’ai ri, j’ai eu les larmes aux yeux, j’ai été émerveillée par les images, portée par la musique, captivée par l’univers.
Et surtout, j’ai ressenti ce que peu de films français savent encore provoquer : une émotion sincère et constante.
On retrouve tout ce qui fait la magie de Kaamelott :
les dialogues, l’humour absurde, la fidélité des personnages, la poésie du banal.
Mais le tout transcendé par une mise en scène plus ample, plus ambitieuse, plus mature.
Je le redis : cette première partie n’est pas une fin, c’est un commencement.
Et si la suite tient ses promesses, le troisième volet sera sans doute magistral.
Le cinéma français n’avait encore jamais osé ce mélange-là : de l’héroïc-fantasy, de la comédie, du drame et de la philosophie dans un même écrin.
Astier l’a fait.
Et il l’a bien fait.
Ma note : 4,4 / 5
Parce que rien n’est parfait, mais que tout sonne juste.
Et parce que je sais, au fond, que le meilleur reste à venir.
💫 Phrase de clôture signature
Quand on sort de la salle, on ne sait plus très bien si on a vu un film ou si on a traversé un souvenir.
Kaamelott n’est plus seulement une série ou une légende : c’est une part de nous qui continue de grandir, lentement, à la lumière du génie d’Astier.
✨ Critique maison réalisée par Emma Mackenzie – Octobre 2025